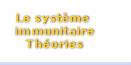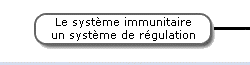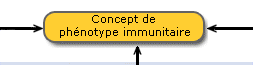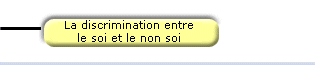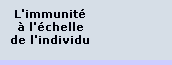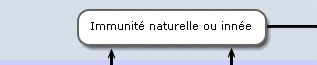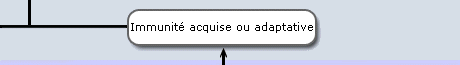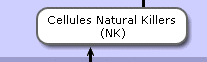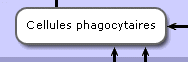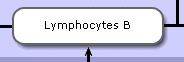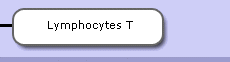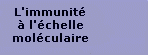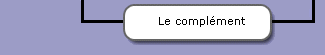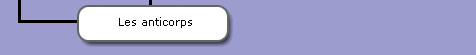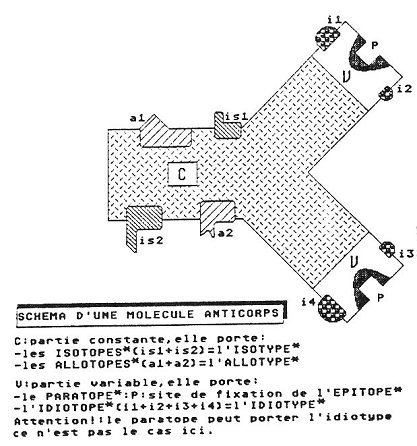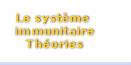 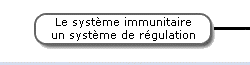 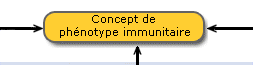 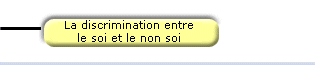
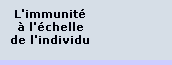 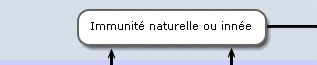 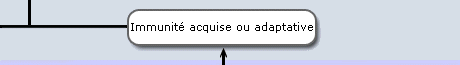
 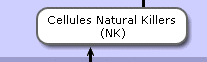 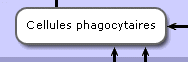 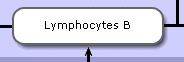 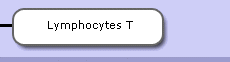
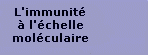 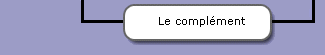 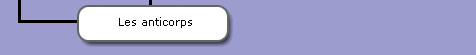
La discrimination entre le soi et le non soi
 L’épineux
problème du terme « antigène » L’épineux
problème du terme « antigène »
Ethymologiquement : « Qui engendre son contraire », c’est à dire
l’anticorps.
Renvoie aux « théories instructionnistes » de Haurowitz
(1930) et Pauling (1940). Selon ces théories, « l’antigène commande la
conformation d’un anticorps malléable »
Les ambiguïtés viendront plus tard, avec les théories
sélectives, du fait que tout anticorps est aussi un antigène, de
l’expression antigènes-HLA pour désigner les marqueurs tissulaires et des
notions d’antigènes immunogènes (dans les phénomènes de rejet) et
d’antigènes tolérigènes (dans les processus de facilitation, sachant aussi
qu’un même antigène, selon la dose peut être immunogène ou tolérigène).
Faudrait-il remplacer le terme d’antigène ?
Molécules « immunogènes »
Molécules « tolérigènes »
Mais alors le problème se déplace sur le mot « immunitaire » qui englobe
normalement le tout et non pas le seul versant « défense ».
1890 - 1920 : Premières théories cellulaires (Metchnikoff – phagocytose),
et humorales de l’immunité (action des facteurs sériques)
1930 – 1950 : Théories instructionnistes
1957 : Théories de la sélection clonale (Franck Mac Farlane Burnet)
1974 : Théorie du réseau idiotypique (Niels Jerne – Prix nobel 1984)
Première définition du concept de Soi/Non soi : 1969 (Franck Mac Farlane
Burnet), en liaison avec le système immunitaire adaptatif. La distinction
primitive, génétiquement programmée du Soi/Non soi de l’immunité innée est
négligée.
Première idée : Le système immunitaire est capable de reconnaître et de
discriminer le « soi », ensemble de molécules propres à l’individu,
constituant son identité immunologique, du « non soi », molécules
étrangères à l’individu.
Toutes les cellules possèdent un ensemble de molécules membranaires
spécifiques, constituant les marqueurs du soi (groupes sanguins, marqueurs
HLA).
La discrimination Soi/Non soi semble claire
Tout se complique avec la théorie de la sélection clonale et l’existence
d’un répertoire immunologique (ensemble de clones de LB et LT
spécifiques).
Le mécanisme génétique « aveugle » de la constitution de ces clones
nécessite en contre partie la mise en place d’un système d’apprentissage
du système, éliminant les clones potentiellement dangereux (clones
auto-réactifs). Ce phénomène est appelé « tolérance au soi ». Ainsi le
« soi » (ensemble des antigènes tolérigènes) ne serait qu’un sous-ensemble
du « non soi » (antigènes immunogènes).
 Le concept d'idiotype (1963) Le concept d'idiotype (1963)
Le concept d’idiotype (J. Oudin – 1963) : En injectant un antigène ou
EPITOPE à un lapin, Oudin fait produire par ce lapin des anticorps AC1. Il
isole ensuite du sérum du lapin immunisé, les anticorps AC1 et les
injectent à un autre lapin qui produit alors des anticorps AC2 anti-AC1.
Les anticorps AC2 sont spécifiques d’AC1, ils ne peuvent se lier aux
autres anticorps du premier lapin spécifiques d’autres épitopes. Les
anticorps AC2 sont spécifiques d’une zone de l’anticorps AC1 nommé
IDIOTYPE situé au niveau de la partie variable de cet anticorps.
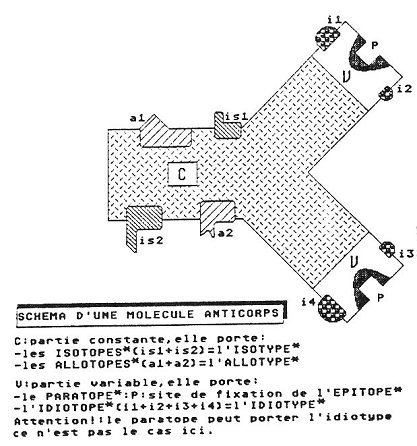
 Théorie du réseau idiotypique – Les
hypothèses de Jerne (1974) Théorie du réseau idiotypique – Les
hypothèses de Jerne (1974)
1°) Les interactions
idiotype/anti-idiotype existeraient au sein d’un même organisme. Elles
permettent l’installation d’un réseau appelé réseau idiotypique
2°) Les récepteurs des LB et LT exposent des idiotypes tout comme les
anticorps circulants. Les millions de clones cellulaires de LB et LT
portent autant d’idiotypes différents qu’il existe de paratopes
différents. Les clones doivent donc se reconnaître les uns les autres par
un réseau d’informations reposant sur la reconnaissance
idiotype/anti-idiotype.
3°) Jerne postule que ce répertoire d’idiotypes propre à chaque individu
constitue l’IMAGE INTERNE de l’ensemble des motifs antigéniques a priori
reconnaissable par le système immunitaire.
4°) Ce réseau est fonctionnel et a deux rôles principaux :
Maintenir actif les clones de LB et LT naïfs, c’est à dire les clones de
LB et LT qui n’ont encore jamais rencontré leur antigène spécifique, mais
qui peuvent « travailler à bas bruit » à partir de l’idiotype
correspondant;
Exercer par cette mise en réseau des clones de LB et LT une inhibition du
système immunitaire, versant rejet, en l’absence de pénétration d’un
antigène.
La pénétration d’un antigène, par un déplacement d’équilibre active la
réponse immunitaire spécifiquement dirigé vers cet antigène.
La théorie du réseau idiotypique renverse l’idée que l’on peut se faire du
non-soi : le non-soi n’est que du soi jusque là inaperçu.
Le répertoire immunogique n’est donc pas déterminé par l’univers extérieur
mais par le monde interne. On ne reconnaît … que le soi. N’est pas
antigène qui veut !
|